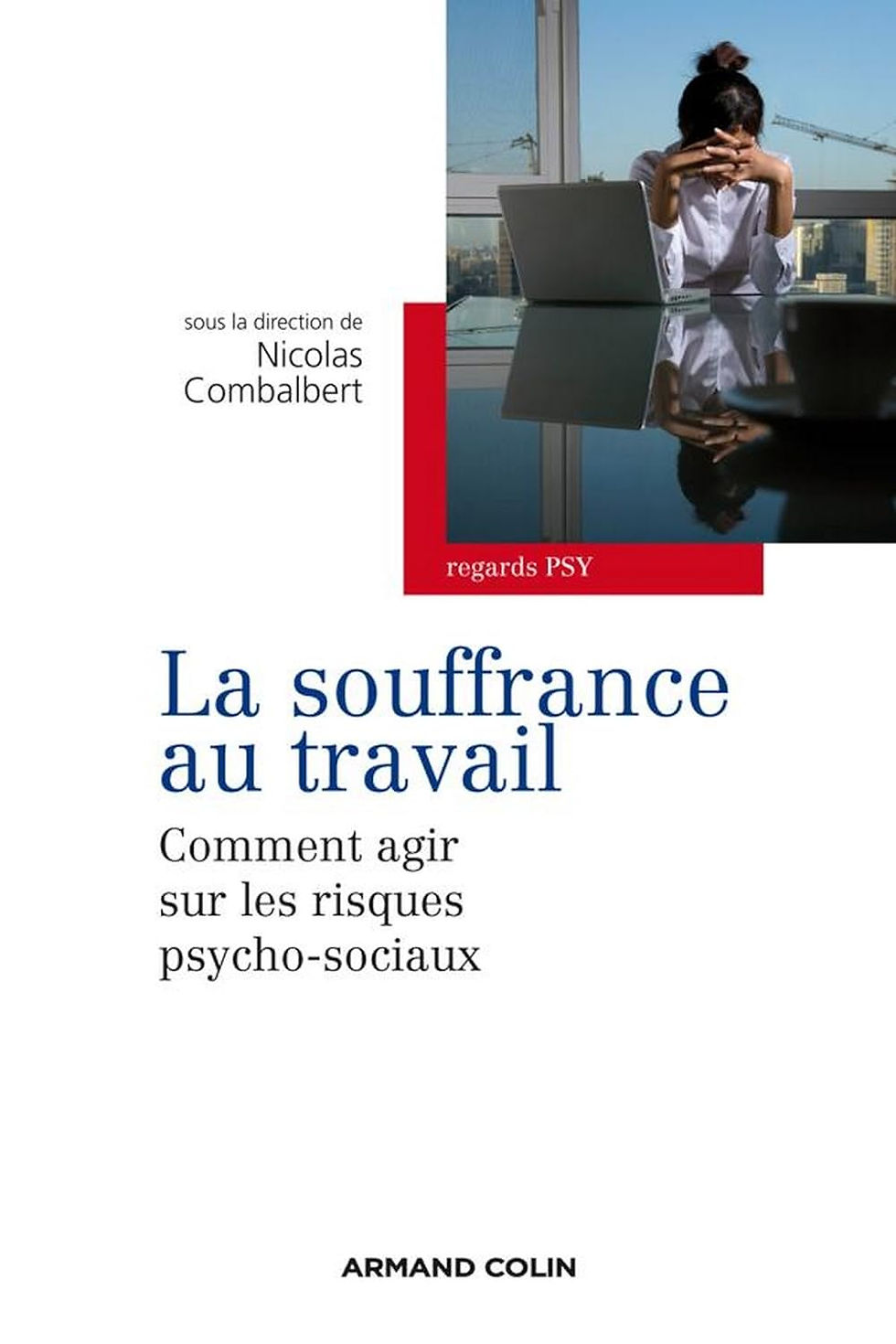Comprendre les troubles psychosociaux par l’approche organisationnelle
- 20 juil. 2010
- 22 min de lecture
Dernière mise à jour : 4 mars
Article publié dans le livre collectif Combalbert, N. 2010. La Souffrance au travail. Comment agir sur les risques psychosociaux?, Paris, Armand Colin.
Vous souhaitez en lire plus ?
Abonnez-vous à arianebilheran.com pour continuer à lire ce post exclusif.